Une rentrée pas si reposante
Septembre est souvent présenté comme un nouveau départ : cartables neufs, emploi du temps tout juste imprimé, bonnes résolutions en pagaille.
Mais derrière cette image de rentrée dynamique et optimiste se cache une autre réalité, bien plus lourde pour une partie de la population : celle des femmes.
Pour beaucoup d’entre elles, la rentrée marque le retour d’une organisation effrénée entre travail salarié et responsabilités familiales. Cette double journée, faite de temps partagés entre bureau et maison, n’a rien d’une nouveauté. Elle s’inscrit dans une continuité historique où les femmes assument encore, et largement, la majorité des tâches ménagères et familiales.
Et loin d’être une simple question d’organisation, cette charge supplémentaire est un facteur puissant d’inégalités professionnelles et personnelles.

Quand la maison devient un deuxième bureau
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
80 % des femmes font la cuisine ou le ménage au moins une heure par jour, contre seulement 36 % des hommes*.
Chaque semaine, elles réalisent en moyenne 10 heures de tâches domestiques de plus que les hommes*. Autrement dit, plus d’une journée de travail complète… mais non rémunérée et souvent invisible.
Cette inégalité ne se limite pas à la sphère privée. Elle a un impact direct sur la santé, la carrière et même la perception sociale des femmes. 62 % des Français reconnaissent que les femmes ne sont pas traitées de la même manière dans la vie du foyer*. Pourtant, ce constat partagé ne suffit pas à enclencher de véritables changements.
La période estivale illustre bien ce déséquilibre. Tandis que l’été est synonyme de repos pour beaucoup, les mères arrivent paradoxalement plus fatiguées à la rentrée que les pères*. Pourquoi? Parce qu’elles assument la plus grande part de l’organisation des vacances : préparation des valises, gestion des repas, activités pour les enfants, anticipation des trajets… Autant de tâches invisibles qui pèsent lourd dans la balance du quotidien.
*Rapport annuel sur le sexisme, 2025 (HCE)

Les impacts d’une charge invisible
Cette double journée n’est pas anodine. Elle entraîne des répercussions concrètes et mesurables :
- Fatigue accrue et risques pour la santé : les femmes ont deux fois plus de risques de faire un burn-out que les hommes*.
- Moins de temps libre : elles participent nettement moins que les hommes aux activités sportives, culturelles, de loisirs, bénévoles ou caritatives**.
- Carrières freinées : ce temps consacré au foyer limite les possibilités de formation, de réseautage ou de prise de responsabilités.
- Renforcement des stéréotypes : la figure de la « superwoman » qui gère tout alimente des attentes irréalistes et culpabilisantes.
Au-delà des conséquences individuelles, cette organisation genrée des tâches reproduit des inégalités systémiques. Elle contribue à alimenter la maternal wall, ce mur invisible qui freine la progression des femmes dans leur carrière dès lors qu’elles deviennent mères.
*Rapport annuel sur le sexisme, 2023 (HCE)
**EIGE, Gender Equality Index 2024
Pourquoi la charge repose encore sur les femmes ?
On pourrait penser que cette inégalité est le fruit de choix individuels. En réalité, elle s’inscrit dans une construction sociale et des normes profondément ancrées. Les petites phrases du quotidien : « il aide beaucoup à la maison », « tu es une vraie maman poule », « c’est un bon père, il va chercher ses enfants à l’école », révèlent que la société continue de considérer les femmes comme les principales responsables du foyer.
La charge n’est pas seulement physique (cuisiner, nettoyer, ranger). Elle est aussi mentale : anticiper, organiser, penser pour les autres. Cette charge mentale, invisible mais omniprésente, reste largement féminine. Et parce qu’elle est difficile à quantifier, elle est aussi souvent minimisée.
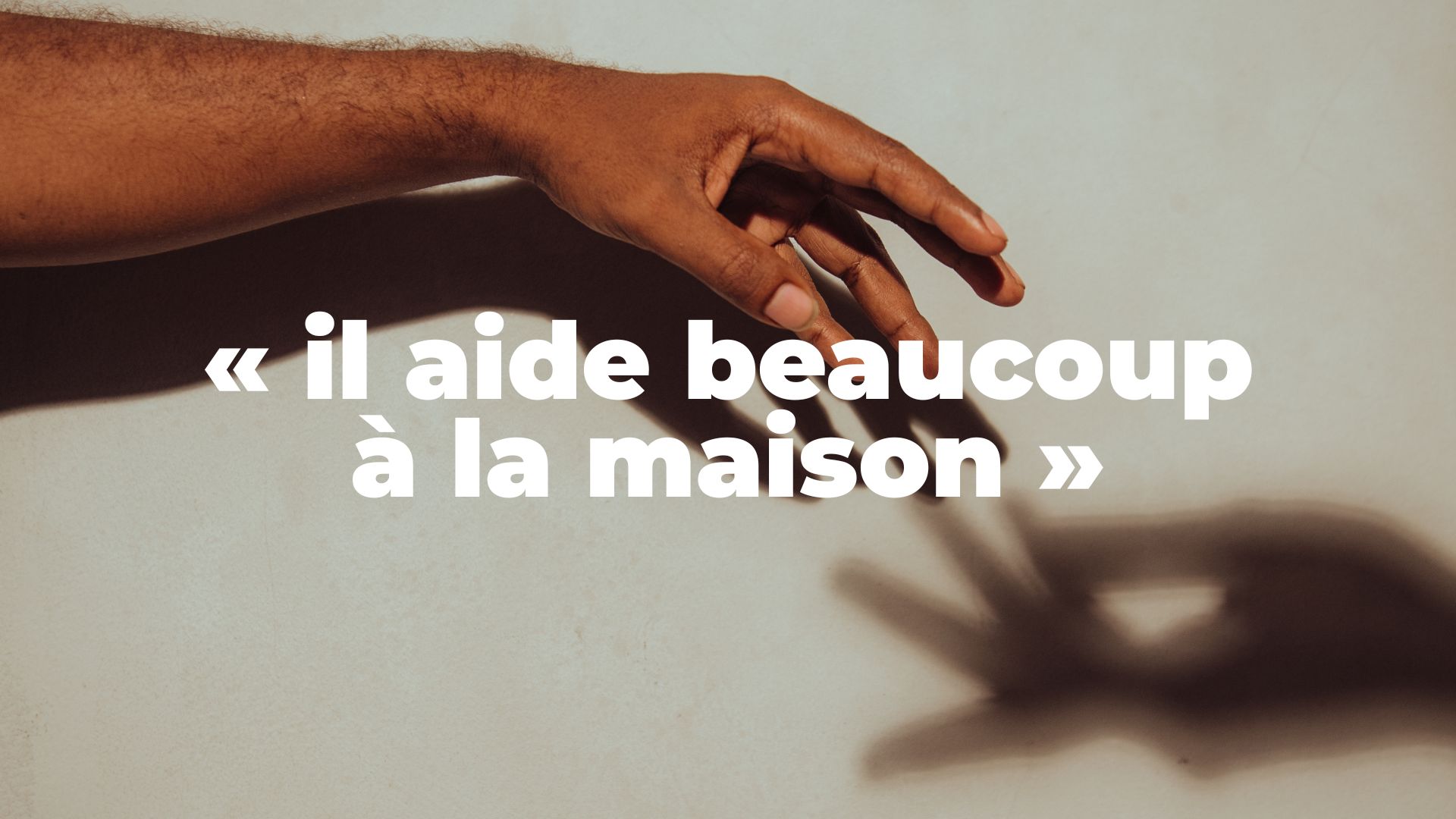
Comment briser le cycle ?
Bonne nouvelle : la double journée n’est pas une fatalité. Elle est le produit d’une organisation sociale, et donc, elle peut être transformée.
Au sein des foyers
- Répartir équitablement les tâches, non pas en « donnant un coup de main », mais en partageant réellement la responsabilité.
- Rendre visibles ces tâches et les valoriser comme un véritable travail.
- Impliquer les enfants dès le plus jeune âge dans les tâches domestiques, pour déconstruire les rôles genrés.
Au niveau des entreprises
- Mettre en place des politiques de parentalité partagée : congés équilibrés, horaires aménageables, droit à la déconnexion.
- Former et sensibiliser les managers à la réalité de la double journée et à son impact sur la progression de carrière. Donner la parole à ses collaboratrices sur le sujet pour augmenter une prise de conscience empathique du sujet.
- Valoriser des modèles masculins impliqués dans la sphère domestique, afin de montrer que l’égalité n’est pas une utopie, mais une pratique possible et bénéfique.
À l’échelle de la société
- Encourager des politiques publiques qui favorisent la conciliation entre vie professionnelle et personnelle.
- Déconstruire les stéréotypes de genre dès l’école.
- Promouvoir la reconnaissance du travail domestique, notamment financièrement dans les débats sur l’égalité.
La rentrée devrait être l’occasion de repartir sur de nouvelles bases, d’ouvrir des perspectives, de créer des opportunités. Mais tant que les femmes continueront à porter sur leurs épaules le poids d’une double journée, ce départ sera faussé.
Rééquilibrer la répartition des tâches, c’est permettre à chacun et chacune de s’épanouir, de se reposer et de s’investir pleinement, au travail comme dans la vie personnelle. C’est aussi adresser un message fort : le temps des femmes vaut autant que celui des hommes.
Derrière les cartables, les agendas et les réunions de rentrée se cache une question plus profonde : comment voulons-nous organiser notre société ? Une société qui perpétue des inégalités invisibles, ou une société qui choisit de reconnaître et de partager équitablement la charge du quotidien.
Il est temps que la rentrée cesse d’être synonyme de surcharge pour les unes et de confort pour les autres. Car une rentrée plus juste, c’est aussi une société plus équitable, plus durable et plus humaine.
