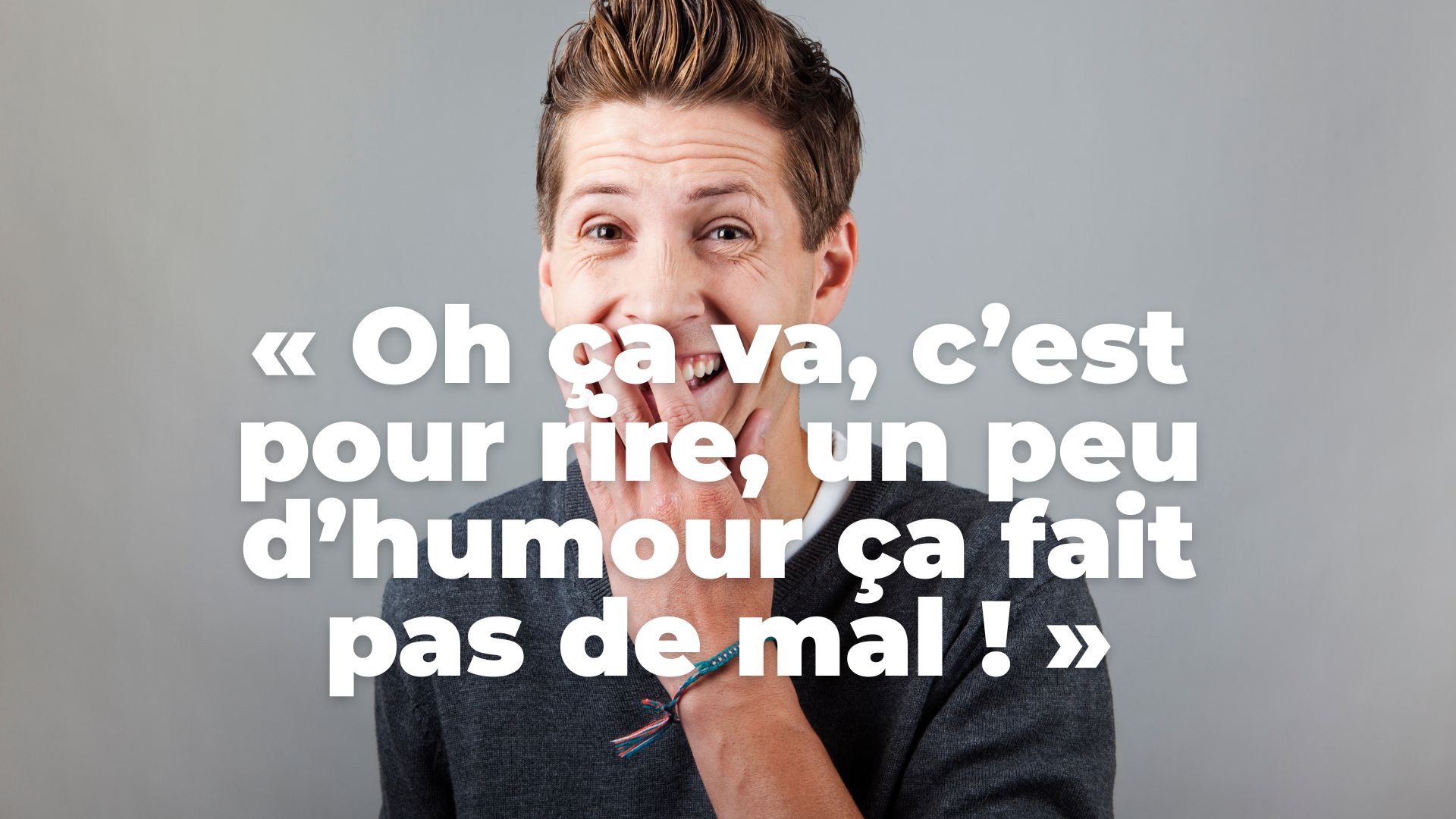
Combien de fois a-t-on entendu cette phrase pour justifier une remarque délicate, une blague douteuse ou un commentaire qui met mal à l’aise ? Si l’humour est souvent perçu comme un outil de légèreté et de convivialité, il peut aussi devenir une arme insidieuse qui perpétue des stéréotypes et renforce les inégalités.
Dans ce cas, on parle d’humour oppressif puisqu’il vise généralement un groupe (souvent minorisé) en particulier. Ce genre de blagues semble notamment pulluler autour de la machine à café, or ce n’est pas sans conséquences.
Comprendre l’impact des blagues sexistes
Les blagues sexistes (tout comme les blagues racistes, validistes, homophobes et on en passe…) peuvent sembler inoffensives à première vue. Elles sont souvent dissimulées sous un manteau de légèreté ou de plaisanterie, mais leur impact réel est loin d’être anodin. Ces remarques, souvent dirigées contre les femmes ou les minorités de genre, contribuent à renforcer les stéréotypes. Sous couvert d’humour, elles réduisent les individus à des clichés et les enferment dans des rôles préconçus : la femme incapable de faire preuve de logique, la stagiaire reléguée aux photocopies ou encore la jeune recrue jugée uniquement sur son apparence.
Loin de provoquer un simple éclat de rire, ces blagues ont des conséquences profondes.
Elles instaurent un climat de malaise et d’exclusion, où les personnes visées se sentent marginalisées ou dévalorisées, ces personnes étant maintenues en position d’infériorité.
Ce type d’humour alimente un environnement toxique, nuit à la collaboration et freine la progression des carrières, en particulier pour les individus déjà sous-représentés.
Quand l’humour devient oppressif
L’humour oppressif ne se limite pas aux blagues sexistes : il inclut toute forme de plaisanterie qui profite d’un déséquilibre de pouvoir ou cible des groupes marginalisés. Qu’il s’agisse de moqueries sur l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le handicap ou encore l’âge, cet humour exploite les vulnérabilités pour générer du rire aux dépens des autres. Car c’est ainsi que fonctionne l’humour de manière générale : il se base sur des références communes au groupe dominant avec pour unique but de faire rire ce même groupe dominant tout en prétendant que la volonté est de faire rire tout le monde…
Ce type d’humour a un effet délétère sur la culture d’entreprise. Il crée une barrière invisible mais bien réelle entre les personnes, renforçant les divisions et érodant la cohésion. Dans un monde professionnel où l’inclusivité et la diversité sont de plus en plus valorisées, tolérer ou minimiser l’humour oppressif envoie un message clair : les préjugés et les discriminations sont acceptables tant qu’elles sont dissimulées sous un vernis d’humour.
Pourquoi les excuses traditionnelles ne tiennent plus
« C’est juste une blague » ou « Il ne faut pas tout prendre au sérieux » sont des excuses fréquemment utilisées pour minimiser l’impact de l’humour oppressif. Pourtant, ces justifications ignorent une réalité fondamentale : le contexte. Une blague sexiste ou oppressive ne survient pas dans un vide ; elle s’inscrit dans une société où les inégalités existent déjà.

Ces « blagues » ne sont pas neutres : elles valident et perpétuent les normes sociales qui excluent certains groupes. Dire que l’humour ne peut pas faire de mal, c’est ignorer les études qui montrent que ce type de communication influence les attitudes et les comportements. En milieu de travail, ces blagues peuvent non seulement décourager, mais aussi pousser certains talents à quitter leur poste pour chercher un environnement plus respectueux.
Selon le baromètre #StOpE 2025, 77 % des femmes salariées déclarent être régulièrement confrontées au sexisme au travail et trois femmes sur quatre déclarent être victimes de blagues sexistes.
Si rien n’est fait pour lutter contre ce type d’humour, comment espérer que des mesures soient prises pour s’attaquer aux problèmes qu’il tourne en dérision ? Et puis, doit-on rappeler que se moquer de personnes marginalisées, ça n’a rien à voir avec de l’humour, mais tout avec du harcèlement.
Créer un humour inclusif pour une culture d’entreprise saine
Doit-on pour autant bannir tout humour au travail ? Absolument pas. L’humour a un rôle essentiel à jouer dans la création de liens, la résolution de conflits et la réduction du stress. Mais il est nécessaire de revoir la définition de ce qui est drôle et acceptable (pour vraiment tout le monde) et d’adopter un humour respectueux et inclusif, qui ne blesse pas, ne marginalise pas et ne perpétue pas le continuum des violences.
S’il est possible d’agir à l’échelle individuelle en se posant notamment la question de l’impact de ses propos et en cherchant le dialogue, tout ne doit pas reposer sur les seules personnes concernées. Ici, le risque serait que toute la charge revienne aux victimes, encore une fois.
Pour assainir la culture de l’entreprise, des mesures doivent être prises à un échelon plus global. Cela passe principalement par de la sensibilisation, au moyen de formations sur la diversité et l’inclusion, sur le sexisme, les discriminations, sans oublier le cadre légal.
Lutter contre les blagues sexistes et l’humour oppressif au travail n’est pas une tâche isolée : c’est un effort collectif. Chaque collaborateur et collaboratrice a un rôle à jouer dans la construction d’un environnement sain et respectueux. Mettre fin aux pratiques d’humour oppressif, c’est envoyer un message fort : chaque personne mérite d’être traitée avec dignité et respect.
Ce n’est que quand il ne se fait plus au détriment d’une personne ou d’un groupe que le rire peut réellement être une force positive, tant au travail que dans la société en général. Il est plus que temps de se créer un référentiel commun à l’image du monde que l’on souhaite : inclusif, respectueux, joyeux, divers et multicolore.
